Si les valises étaient bien au rendez-vous cet été entre océan et montagne, les portefeuilles, eux, se sont un peu allégés. Avec 7,6 millions de visiteurs en juillet-août, la fréquentation globale est restée quasiment stable par rapport à 2024 (-0,6 %). Une performance qui confirme l’ancrage touristique du département, même si l’on observe une modification des comportements : plus d’excursionnistes (+1 %), mais moins de touristes logés (-4 %), notamment en raison de la baisse de l’offre de meublés au Pays basque.
Autre tendance marquée : la haute saison, désormais concentrée sur le mois d’août, a véritablement pris son envol à partir du 2 août, comme un retour à la situation d’avant-covid. Mais si les estivants ont fait le plein, leur panier moyen a baissé, près d’un professionnel sur deux déclarant une diminution de la consommation. Une météo favorable et une offre variée n’ont pas suffi à compenser un contexte économique plus tendu.
Les hôtels et campings tiennent la barre
Côté hébergement, les hôtels du 64 affichent une stabilité réjouissante : 83 % de taux d’occupation, identique à l’an dernier, mais avec un chiffre d’affaires en hausse de 4 %. Une performance liée notamment à une bonne gestion tarifaire et à la fidélisation des clientèles. Les campings n’ont pas démérité non plus : près de deux sur trois se disent satisfaits de la saison, confirmant l’appétence du public pour une formule plus souple et conviviale.
Les meublés touristiques, en revanche, ont subi les effets de la mesure de compensation en zone tendue au Pays basque. Le nombre de nuitées est en retrait de 8 %, même si le taux d’occupation progresse de trois points (61 % contre 58 % en 2024). Une conséquence logique d’une capacité d’accueil réduite, mais qui a permis de limiter les « lits froids » en remplissant mieux les logements disponibles. Le chiffre d’affaires, lui, progresse grâce à la hausse des prix (+13 %).
En Béarn, des séjours qui prennent racine
Avec 2,5 millions de visiteurs, le Béarn connaît une légère baisse de fréquentation (-1 %), et perd 2 % en nuitées sur août. Mais derrière cette stabilité apparente se cachent des signaux positifs. Contrairement à la tendance nationale, la durée moyenne des séjours augmente grâce aux séjours longs d’une semaine ou plus (+5 %). Autrement dit, si les visiteurs sont un peu moins nombreux, ils restent plus longtemps.
Le Béarn continue aussi de séduire deux cibles stratégiques : les jeunes actifs de 25-34 ans et les familles, véritables piliers de sa stratégie marketing. Quant aux « clientèles historiques » comme les Pays de la Loire et l’Espagne, elles ont répondu présent (+5 %), confirmant la pertinence du cap fixé par l’ADT64. À l’inverse, d’autres marchés marquent le pas, comme l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est (-7 % chacun), ou encore le Benelux (-13 %).
Dans le détail, certains territoires s’illustrent : Pays de Nay (+10 %), dopé par deux passages du Tour de France, et Béarn des Gaves (+23 %), porté par un afflux venu du littoral basque. À l’inverse, la Vallée d’Ossau (-7 %) a vu sa fréquentation chuter brutalement après le 15 août, signe que les aoûtiens ont plié bagage une semaine plus tôt que d’habitude.
Le Pays basque garde le cap
Avec 5,4 millions de visiteurs, le Pays basque conserve sa fréquentation de 2024, malgré une baisse du nombre de nuitées (-5 %). La raison principale reste la diminution de l’offre de meublés liée à la régulation en zone tendue. Mais cette réduction a permis de remplir davantage les logements restants, avec un taux d’occupation en hausse de 61 %.
Les clientèles de proximité – Gironde, Haute-Garonne et Espagne – ont permis de maintenir l’activité, compensant partiellement le recul des clientèles d’Île-de-France (-5 %), des Pays de la Loire (-7 %) et des Hauts-de-France. Mais la consommation a changé de visage : les clientèles aisées ont marqué le pas (-3 %), tandis que la classe moyenne, plus présente (+2 %), s’est montrée moins dépensière.
Sur le terrain, le littoral recule légèrement (-2 %), tout comme Saint-Jean-Pied-de-Port et la Soule (-6 % chacun). Mais deux territoires tirent leur épingle du jeu : les Aldudes (+8 %), avec une explosion des visiteurs franciliens (+48 %) et une forte présence de clientèles populaires, et la campagne basque (+6 %), qui séduit une clientèle jeune (+17 %), urbaine (+11 %) et familiale. Une démonstration éclatante que le Pays basque ne se résume pas à ses plages.
Un mois de septembre sous surveillance
Si l’été a tenu ses promesses, l’arrière-saison reste plus incertaine. En septembre, plus de 60 % des réservations se font en dernière minute, ce qui rend les anticipations délicates. Près d’un visiteur sur deux attendu a plus de 55 ans, signe d’une fréquentation en décalage avec les familles de l’été.
En Béarn, les réservations sont en léger retrait (-2 %), la météo incertaine pesant sur les choix de dernière minute. Au Pays basque, elles reculent de 4 %, toujours à cause de la baisse de la capacité d’accueil et d’une météo capricieuse. Mais les professionnels se disent malgré tout confiants, misant sur un mois de septembre historiquement porteur et sur l’attrait intact des paysages, du patrimoine et de la gastronomie locale.
En résumé, l’été 2025 aura confirmé que le Béarn et le Pays basque restent des escales incontournables, même si la consommation a ralenti. Les hôtels et campings ont fait le plein, les meublés se sont adaptés, et les clientèles de proximité ont sauvé la saison. Mais l’équilibre reste fragile, et les professionnels savent que les touristes d’aujourd’hui ne se contentent plus de paysages : ils veulent du sens, de l’expérience, et des prix ajustés à leur budget.
Cet été, le département a su garder son cap malgré la houle économique. Qu’ils viennent pour les montagnes du Béarn ou les vagues du Pays basque, les voyageurs continuent de considérer le 64 comme une destination de choix. Leurs bagages sont peut-être plus légers… mais leur envie d’évasion reste intacte.
Sébastien Soumagnas
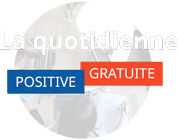





Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire