Avant d’être un événement phare inscrit en lettres d’or dans l’agenda culturel du Pays basque et même au-delà, le Festival Ravel est le fruit d’une histoire longue, patiemment composée comme un allegro moderato. Ses origines remontent à 1960, lorsque Pierre Larramendy, maire de Saint-Jean-de-Luz, fonde la Grande Semaine de Saint-Jean-de-Luz, bientôt rebaptisée Musique en Côte Basque. À l’époque, l’idée est simple : offrir, au cœur de l’été, un rendez-vous où la musique classique se joue face à l’Atlantique. La première édition célèbre en grande pompe le tricentenaire du mariage de Louis XIV avec l’Infante Marie-Thérèse d’Autriche.
Au fil des années, la manifestation s’installe, attirant de véritables têtes d’affiche, comme Arthur Rubinstein, Martha Argerich, Aldo Ciccolini… En 1967, Pierre Larramendy élargit la portée du projet en créant l’Académie Ravel, conçue comme une pépinière de jeunes talents. Très vite, la complémentarité s’impose, avec d'un côté, une scène prestigieuse qui accueille les plus grands interprètes, et de l’autre, un lieu d’apprentissage qui prépare les générations futures.
En 2007, année marquant les 70 ans de la mort de Ravel, les deux entités collaborent plus étroitement. Dix ans plus tard, en 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine, Musique en Côte Basque et l’Académie Ravel coproduisent un premier « Festival Ravel » officiel, préfigurant la fusion de 2020. Ce mariage artistique, scellé sous la présidence de Jean-François Heisser et la direction artistique conjointe de Bertrand Chamayou, réunit deux héritages pour mieux écrire l’avenir.
Ravel, un siècle et demi de musique
Cette année, le Festival Ravel prend un ton solennel puisqu'il s’agit de fêter les 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, né en 1875 à Ciboure, dans cette maison hollandaise qui surplombe le port de Saint-Jean-de-Luz. « L’océan a été son berceau, surplombé par la Rhune ou les Trois Couronnes, et Ravel a toujours exprimé sa fierté d’être basque et d’en maîtriser la langue », rappelle Bertrand Chamayou.
Pour l’occasion, le directeur artistique a choisi une programmation « encyclopédique » : l’essentiel de la musique symphonique, du piano, de la musique de chambre et vocale du maître, mais aussi les œuvres de ceux qui l’ont inspiré ou prolongé. Du Concerto pour la main gauche à Daphnis et Chloé, de Ma mère l’Oye à la Rapsodie Espagnole, le répertoire se déploie comme une vaste fresque orchestrale, avec la présence de phalanges prestigieuses : l’Orchestre de l’Opéra national de Paris (Thomas Adès), l’Ensemble intercontemporain (Pierre Bleuse), l’Orchestre National de France (Philippe Jordan), l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (Joseph Swensen), l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (Jean-François Heisser) et l’Orchestre national du Capitole de Toulouse (Tarmo Peltokoski).
Cette édition, outre les grands classiques, propose des expériences inédites. Ainsi, le plasticien Anri Sala présentera son installation Ravel Ravel Revisited autour du Concerto pour la main gauche, en clôture. Une journée entière sera consacrée au Boléro, revisité dans plusieurs styles, et un hommage vibrant à Erik Satie ponctuera les festivités. Le compositeur basque Ramon Lazkano, en résidence, créera l’opéra La Main gauche, inspiré du roman Ravel de Jean Echenoz, confié à l’Ensemble intercontemporain ainsi qu'à trois solistes vocaux.
L’Académie Ravel, la relève en répétition
Si le Festival est la scène, l’Académie Ravel en est la coulisse. C’est là que se prépare, dans l’ombre des projecteurs, la relève de demain. Fidèle à son héritage, l’Académie perpétue la tradition d’une école française attentive à l’excellence et ouverte sur le monde.
En 2025, elle élargit encore son champ. En effet, deux nouvelles classes voient le jour, flûte et clarinette, dirigées par Nicolas Baldeyrou et Sophie Cherrier. Le collège des professeurs mêle compagnons historiques et nouvelles figures, dans un esprit de transmission vivante. « Des binômes de professeurs aux approches complémentaires ont été constitués, illustrant parfois une filiation entre maître et élève », souligne Bertrand Chamayou, citant l’exemple de la classe de violoncelle et piano où Sol Gabetta et lui-même dialoguent avec leurs anciens mentors, Ivan Monighetti et Jean-François Heisser.
Les étudiants bénéficient aussi de masterclasses avec les compositeurs invités du Festival, et certains sont directement intégrés à la programmation. L’Académie joue ainsi pleinement son rôle de tremplin, en multipliant les opportunités de se produire, en Nouvelle-Aquitaine et au-delà.
Un programme en crescendo
Le Festival Ravel 2025 ne déroule pas uniquement sur un répertoire. En effet, il raconte une histoire en dix jours, comme une grande symphonie en plusieurs mouvements. Le 28 août, l’ouverture résonnera fort avec le Concerto pour la main gauche, sous les doigts de Kirill Gerstein et la baguette de Thomas Adès. Les jours suivants, chaque soirée proposera un éclairage différent sur Ravel, comme le piano solo le 2 septembre, l’inspiration espagnole le 4, le chant populaire le 6.
Cette dernière journée révèlera un Ravel arrangeur de mélodies traditionnelles, depuis les chants basques jusqu’aux chansons populaires d’Europe et d’ailleurs. « Un visage plus méconnu mais non moins brillant de son génie », insiste Chamayou.
En parallèle, la programmation célèbre d’autres anniversaires. Parce que cette année est marquée par les cent ans de la disparition d’Erik Satie, le centenaire de Pierre Boulez, et les 100 ans de la naissance de Luciano Berio. Le 30 août, la pièce Vexations de Satie sera répétée… 840 fois ! Une performance au fort de Socoa, entre concerts, déjeuner insolite et interventions musicales, créera un moment hors du temps.
Ravel et ses influences, héritages et créations
Cependant, le Festival Ravel 2025 ne se veut pas figé dans la nostalgie. Il invite les musiques qui ont nourri Ravel et celles qui, aujourd’hui, s’inspirent encore de lui. Du jazz aux musiques traditionnelles, des chants populaires aux créations contemporaines, le dialogue se tisse comme une fugue entre passé et présent.
Les jeunes solistes de l’Académie insuffleront leur énergie à ces dix jours, partageant la scène avec des musiciens confirmés. C’est cette cohabitation intergénérationnelle qui donne au Festival sa singularité, à savoir un lieu où la virtuosité rencontre l’audace, où les maîtres passent le relais à leurs cadets, où chaque note est une passerelle.
À l’heure où la musique classique cherche de nouveaux publics, le Festival Ravel offre un ancrage territorial fort, un répertoire exigeant mais accessible, et une volonté de relier les générations. Comme le résume Bertrand Chamayou, « Nous vous attendons nombreux pour ce grand voyage ravélien qui promet déjà d’être inoubliable. »
En 2025, le Pays basque se mettra donc à l’heure de Ravel, entre océan et montagnes, tradition et création. Dix jours pour plonger dans une œuvre qui, cent cinquante ans après sa naissance, continue de parler au monde entier. C'est le moment pour redécouvrir, au fil des concerts, qu’en musique comme en mer, c’est parfois la houle du passé qui pousse les voiles de l’avenir.
Sébastien Soumagnas
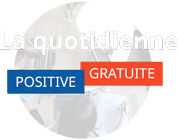





Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire