Il y a des lieux que l’Histoire oublie volontairement, comme si les fissures trop visibles menaçaient la façade du récit national. L’Île des Faisans est de ceux-là. Un confetti diplomatique posé au milieu de la Bidassoa, alternant tous les six mois entre souveraineté française et espagnole. Un théâtre d’ombres administratives devenu, dans le film d’Asier Urbieta, le décor d’un drame glaçant.
Le 23 avril, L’Île des Faisans sort en salles. Premier long-métrage du cinéaste basque Asier Urbieta, ce thriller tendu et politique s’inspire d’un fait divers survenu à la frontière franco-espagnole : un corps sans nom retrouvé sur cette île inhabitée que les deux États se partagent. En trois ans, neuf migrants ont péri dans la Bidassoa en tentant de traverser ce trait d’union entre Hendaye et Irun. Noyés. Écrasés par des trains. Avalés par l’indifférence.
La mécanique est absurde. Cette minuscule île, de quelques centaines de mètres carrés, est gérée alternativement tous les six mois par la France et l’Espagne. Et lorsqu’un cadavre y est découvert – comme dans le film – il devient objet de dispute ou de silence, selon le calendrier. À qui revient la responsabilité ? À qui incombe l’identification ? Quid du droit ?
C’est autour de ce nœud géopolitique qu’Urbieta construit son récit. L’Île des Faisans s’ouvre sur la découverte d’un corps échoué sur la rive. Aucune pièce d’identité, aucun signalement. Laida, une jeune femme habitant non loin, se souvient de deux jeunes hommes vus quelques jours plus tôt, sautant dans la rivière pour fuir une interpellation. L’un a survécu. L’autre a disparu.
Frontière en eaux troubles
Aux côtés de Tania, une militante de l’accueil des exilés, Laida tente de donner un nom à ce mort sans sépulture. Ensemble, elles plongent dans l'imbroglio administratif, affrontent le mutisme institutionnel, butent sur l’inertie des États. La frontière devient ici le véritable protagoniste. Urbieta en fait une entité, une tension permanente, une ligne de fracture à la fois géographique, politique et intime.
Car au fil de l’enquête, c’est aussi le couple de Laida et Sambou qui se désagrège. L’histoire d’un amour traversé par des réalités divergentes, par l’écart entre convictions et survie. Le film creuse là où ça fait mal : dans le quotidien de ceux qui vivent en périphérie du confort européen.
Ce qui frappe dans L’Île des Faisans, c’est sa capacité à faire résonner une situation locale avec un questionnement universel. En transformant un fait divers en thriller psychologique, Urbieta expose le réel. Les disparus de la Bidassoa deviennent les symboles des zones grises du droit international, des angles morts des politiques migratoires.
« J’ai voulu créer une atmosphère lourde et un regard profond qui s’abreuve de la réalité pour devenir un film qui donne envie d’agir et de repenser nos modèles du vivre ensemble », confie le réalisateur. Et c’est bien ce que l’on ressent à la sortie du film, à savoir un mélange d’impuissance et de colère, mais aussi le désir d’en savoir plus, de ne pas tourner la page.
Asier Urbieta filme là où les regards se détournent
Produit par La Fidèle Production (France) en collaboration avec Arcadia Motion Pictures (Espagne) et Tentazioa, L’Île des Faisans bénéficie d’un soin artistique exigeant. Le casting y est pour beaucoup : Jone Laspiur, révélée dans Akelarre, incarne Laida avec une justesse qui transperce l’écran. Itziar Ituño, célèbre pour son rôle dans La Casa de Papel, prête sa voix et sa présence à un personnage secondaire mais crucial.
La caméra d’Urbieta, tout en discrétion, accompagne les silences, les hésitations, les doutes. Elle sait aussi capturer la violence – celle d’un corps sans vie, d’un État sans visage, d’un monde sans refuge.
Asier Urbieta n’en est pas à son premier combat filmé. Son travail précédent, la série Altsasu, revisitait un procès hautement politisé dans lequel de jeunes Basques avaient été accusés de terrorisme. Dans Pim Pam Pun, il abordait de front la question des violences policières en Euskadi.
Avec L’Île des Faisans, il change de format, mais pas de cap. Il poursuit une œuvre profondément ancrée dans la réalité sociale, questionnant les rapports de force et les lignes de faille de la société contemporaine. Une caméra braquée sur ce que d’autres préfèrent laisser hors-champ.
Primé avant même le clap de sortie
Preuve de la pertinence de son sujet et de sa mise en scène, le film a déjà fait le tour des festivals européens. Présenté en première mondiale à Göteborg en janvier, il a enchaîné les sélections : Malaga, Barcelone, et bien sûr Saint-Sébastien, au prestigieux Festival de Cinéma et des Droits Humains.
À chaque étape, le public ressort bouleversé. Non par la grandiloquence, mais par la précision du propos. Par ce fil tendu entre la fiction et le documentaire, par cette capacité à raconter l’Histoire à travers une histoire.
Installée au Pays Basque, La Fidèle Production accompagne depuis plusieurs années un cinéma indépendant, audacieux et engagé. On lui doit notamment Les Sorcières d’Akelarre (5 Goya en 2021), Nora, ou encore En Bonne Compagnie, portrait sensible du droit à l’avortement au Pays Basque dans les années 70.
Quoiqu'il en soit, L’Île des Faisans n’est pas un film sur les migrants. C’est un film sur nous. Sur ce que nous acceptons de ne pas voir. Sur ce que le cinéma peut faire quand le réel se tait. À voir, à discuter, à ne pas oublier.
Sébastien Soumagnas
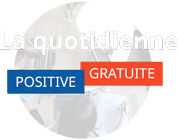





Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire